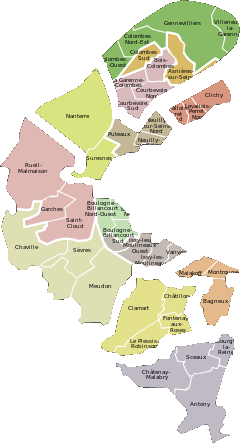« Comble de droit, comble de l’injustice ». Summum jus, summa injuria. Cet adage cicéronien pourfend l’application stricte et aveugle des lois, celle qui ne tiendrait aucun compte des cas auxquels elles doivent s’appliquer. Les tribunaux d’arbitrage ne se soucient guère des particularités, et même le plus consciencieux des juges aurait grand mal à prendre une décision juste. Il ne serait pas en cause, bien qu’une participation à de telles instances s’accompagne généralement de cachets alléchant, car le problème fondamental posé ici est celui du cadre juridique. Un tribunal arbitral, en droit international du commerce, peut être saisi pour régler un litige entre personnes morales – particuliers et entreprises – et Etats. Il va sans dire que, dans l’immense majorité des cas, ce sont des firmes multinationales (FMN) qui attaquent des Etats. Cette question a été récemment évoquée dans le cadre des négociations pour le Grand Marché Transatlantique. Mais il faut resituer cette pratique dans une perspective plus générale.
Ce mécanisme juridique a été très peu utilisé avant les années 1990. Auparavant, la plupart des litiges concernant la protection des investissements devaient se régler devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), que seuls les Etats peuvent saisir ; à la faveur de la contre-révolution néolibérale et compte tenu du blocage des négociations à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les Etats-Unis ainsi que nombre de grandes puissances économiques occidentales multiplient les traités bilatéraux de protection des investissements avec des Etats dont les économies sont fortement dépendantes des capitaux provenant du centre. La caractéristique essentielle de ces traités est la définition extrêmement large qu’ils donnent de l’investissement. Un seul exemple suffit, tant, de l’un à l’autre, leur rédaction est similaire : dans l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République turque sur l’encouragement et la protection des investissements, est qualifié d’investissement « tout type d’avoirs investis par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante ». Toute violation à ce principe, nationalisation non conforme aux termes du traité, ou encore non-remboursement d’une partie de la dette, peut entraîner la saisine d’un tribunal d’arbitrage. Autrement dit, le capital peut remettre en cause toute décision souveraine d’un Etat devant des institutions qui trahissent le principe d’obligations réciproques. Les Etats n’ont qu’un devoir, celui de répondre servilement à toutes les exigences qui leur sont imposées, et les FMN que des droits. Aussi, le mieux qui puisse arriver à un Etat dans le cadre d’un arbitrage de ce type, c’est de n’être pas condamné. Les FMN ne sont pas responsables juridiquement. Elles peuvent battre et violenter la souveraineté d’un Etat sans en recevoir le moindre coup. A cela s’ajoute un principe problématique souvent intégré à ces traités : le traitement de la nation la plus favorisée. Les standards de chaque traité signé doivent s’aligner sur le traitement le plus favorable parmi les traités bilatéraux d’investissement. Cela signifie que les termes d’un accord peuvent être amendés en cas de signature ultérieure d’un traité encore plus favorable aux investissements. L’instabilité et l’incertitude menacent alors les gouvernements.
Les enjeux liés aux tribunaux d’arbitrage censés juger les Etats, via la procédure de saisine par des personnes morales, ont une apparence technique rebutante. Ils n’en sont pas moins fondamentalement politiques. A la souveraineté politique est opposée la volonté d’acteurs privés dont la puissance peut parfois dépasser celle des Etats eux-mêmes. Pour n’en citer qu’un, le cas aberrant du conflit opposant Vatenfall, grand groupe suédois, à l’Allemagne est instructif : le gouvernement de la RFA décide d’arrêter sa production d’énergie nucléaire, et Vatenfall estime devoir toucher 3,7 milliards d’euros de compensation : il s’agit bien, sous couvert de dispositifs techniques visant à empêcher les peuples souverains et leurs gouvernements de prendre des décisions nuisant aux intérêts des FMN et de leurs actionnaires. Ainsi, un ancien haut fonctionnaire canadien raconte, 5 ans après la signature de l’Alena, qui contient un tel dispositif : “J’ai vu des lettres des cabinets d’avocats de NY et Washington arriver au gouvernement canadien pour chaque nouvelle régulation environnementale. Toutes les initiatives ont été visées et la plupart n’ont jamais vu le jour”.
Ce mécanisme antidémocratique est une insulte continue à la souveraineté des peuples. Il est intolérable pour une gauche cohérente. Il peut nuire aux Etats périphériques dont l’économie repose sur l’extraction des ressources naturelles. Il est bon de se rappeler la Résolution 1803 adoptée en 1962 par l’Assemblée Générale des Nations Unies : « 1) Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’Etat intéressé. 2) La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités ». Voilà qui peut donner de la lecture aux rapaces de Chevron-Texaco qui attaquent scandaleusement le gouvernement équatorien.